Les actualités
Cerep-Phymentin
Les actualités
de nos établissements
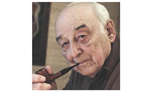
À l'occasion de la parution du livre « Le sujet dans la psychanalyse aujourd'hui » de Raymond Cahn, Marie-Noëlle Clément (psychiatre et médecin directeur de l’hôpital de jour pour enfants André Boulloche) et Serge Tisseron (psychiatre et psychanalyste) sont allés recueillir le témoignage de l’auteur sur « sa vie et son o᠌euvre ».
Les thèmes abordés au cours de l'entretien ont été regroupés en cinq parties, qui souvent se recoupent : l’enfance d’un psychanalyste, les années de formation, de l’apprentissage de la psychanalyse à la présidence de la SPP, la rencontre avec l’œuvre de Winnicott, et enfin la rencontre avec Denise Weill et la création du CEREP.
Nous ne publions ici qu'un extrait portant sur sa rencontre avec D. Weill, au Jeune Atelier rebaptisé plus tard le Cerep par Raymond Cahn lui-même.
Psychiatre et psychanalyste, ancien Président de la Société Psychanalytique de Paris (SPP), Raymond Cahn a également dirigé l’hôpital de jour pour adolescents du Parc Montsouris (CEREP).
Les obstacles ont été multiples dans l’externat de Denise Weill, externat dans un premier temps et ensuite hôpital de jour. Elle avait du culot à l’époque, elle s’était entourée de quelques psychologues et quelques éducateurs dont « la compétence était devant eux », et qui l’ont acquise petit à petit.
MN.C. - Ils avaient « la compétence devant eux », c’est une belle expression !
C’est un membre de l’équipe qui m’a rendu visite il y a deux ou trois jours qui m’a rappelé cela. Catherine Yelnik, qui est une fille charmante et compétente, et qui disait que ce qui était important pour elle dans sa relation avec moi, c’est que je faisais confiance aux gens et que je les laissais travailler comme ils l’entendaient, ce qui était la meilleure façon de pouvoir attendre d’eux des questions, des échanges, qui pourraient apporter aux uns et aux autres des avancées éventuelles. Ça me paraissait tellement évident. Je vais vous dire mon secret. Si j’avais cette attitude là avec mes collaborateurs, c’est que je ne m’imaginais pas que je puisse en avoir une autre, parce que c’était par ces échanges que j’apprenais les choses. Ce n’était pas parce que moi j’avais une science transmissible, c’était plutôt, toujours par rapport à Winnicott, à partir, d’une interrogation commune et qui nous amenait à un échange…
Donc j’ai appris avec eux au CEREP. C’est aussi un sigle qui vient de moi, et un sigle qui est un peu honteux, provocant, car juxtaposant rééducation et psychothérapie. C’était bien pourtant notre finalité. C’était aussi l’époque où l’on créait des hôpitaux de jour un peu partout et notamment auprès des associations privées, faute d’initiatives du côté des structures publiques. J’ai été amené par la suite à être sollicité par la préfecture, pour créer une autre structure de soins dans le 10e arrondissement. J’ai refusé parce que je ne voulais pas consacrer tout mon temps au public.
MNC. - Et quand avez-vous commencé à créer votre propre structure ?
RC - Il se trouve qu’un membre du Conseil d’administration de notre association était un promoteur immobilier à Paris. Et il m’a proposé de consacrer trois étages d’un immeuble à la création d’un hôpital de jour. En fait, c’était notre président qui nous poussait à faire des choses qui nous fatiguaient a priori. Ledit président, c’était un ancien ministre de De Gaulle, ancien résistant, un homme assez remarquable et qu’on avait connu dans des circonstances qui seraient trop longues à décrire et qui n’ont pas grand intérêt. Enfin, toujours est-il qu’un jour il nous a dit : « Bientôt ça va être le énième plan », parce qu’à ce moment-là, en France, on fonctionnait par plans. Alors c’était le énième plan, et il a ajouté : « Est-ce que vous auriez quelque chose à proposer qui pourrait être intéressant ? ». On s’est dit : « On pourrait peut-être quand même essayer de s’agrandir, on est trop à l’étroit pour des petits enfants psychotiques dans des lieux trop urbanisés ». Vous le savez bien puisque vous y êtes toujours1, et nous avons obtenu des crédits pour régler les sommes qui correspondaient à l’aménagement de ces trois étages de cet immeuble. J’étais en excellent termes avec le patron de la DASS de Paris et j’y suis allé, je vais dire, la gueule enfarinée, et je lui ai demandé l’autorisation d’ouvrir un hôpital de jour transférant l’hôpital de jour du Faubourg Poissonnière à Montsouris. Et il m’a dit non. J’étais stupéfait devant ce non. Je lui ai demandé : « Mais pourquoi ? » « Parce qu’il y a trop d’hôpitaux de jour pour enfants sur la rive gauche, vous faites d’autres propositions et nous verrons ». Quinze jours plus tard je suis retourné le voir et je lui ai dit « Et pourquoi pas des adolescents ? ». « Ah ! C’est une excellente idée. » C’est comme cela que les choses se sont passées. Mais il y a eu un fait imprévu : l’équipe tout entière n’a pas voulu émigrer ! Je ne sais pas pourquoi exactement, j’ai quelques hypothèses, enfin peu importe, de sorte que je me suis trouvé dans cette situation assez extraordinaire de créer avec les fonds de l’Etat une structure de soins où j’étais moi-même mon propre recruteur de l’ensemble de l’équipe psychiatrique. Je ne sais si vous vous rendez compte ! Alors je ne savais pas ce que j’allais faire et je vous assure que je ne le sais toujours pas. Par contre je savais très bien ce dont je ne voulais pas. Ce dont je ne voulais pas c’était des suiveurs, des gens comme moi au départ, des gens conformistes, des gens qui risquaient, dans leur œdipe classique, d’avoir une soumission aux parents et une agressivité sous-jacente difficile à travailler. Alors j’ai cherché par tous les moyens, y compris par des annonces dans le journal Le Monde. L’annonce précisait simplement qu’il s’agissait de jeunes gens ayant des difficultés et pour lesquels des méthodes inhabituelles devaient être envisagées. Puis j’ai vu arriver par exemple un ancien du Kibboutz et qui avait l’habitude des adolescents normaux. Et c’est ainsi que j’ai engagé une équipe délibérément hétérogène, associant des gens qui avaient une expérience de psychotiques adultes, de psychotiques enfants, d’enfants caractériels, d’enfants délinquants, d’adolescents délinquants ou d’adolescents simplement borderline… Mais aucun d’entre nous, y compris moi-même, n’avions guère eu l’occasion d’établir des relations thérapeutiques avec des adolescents psychotiques. C’était notre découverte à nous tous collective. A partir d’une virginité commune, nous allions essayer de voir ce qu’on pouvait réaliser.
Par exemple, nous avions une des mères de psychotiques du CEREP, qui était décoratrice. Elle nous a proposé de nous indiquer quelles étaient les peintures au mur qui seraient les plus sédatives et les plus adéquates par rapport à tous ces jeunes. On a accepté. On a eu des meubles fonctionnels très bien, on était très contents, et puis on a commencé à accueillir des adolescents. Et puis au bout de quelques semaines, on pouvait faire du petit bois avec tous les meubles, et les murs étaient complètement détériorés. Bon, c’était notre apprentissage aussi. Et on a fait ce qu’on ne pouvait pas ne pas faire, c’est-à-dire : demander à tous ces garçons et ces filles de reconstruire ce qu’ils avaient cassé. Et c’est à ce moment-là que l’aventure a commencé.
Pour vous représenter les choses, imaginez l’aristocratie dans un donjon protégé de toutes les perturbations du monde extérieur, et qui visait uniquement à accomplir dans les meilleures conditions possibles l’œuvre de Freud. A savoir une certaine qualité d’écoute, un certain mode de réponse à la relation dont devait émerger un objet qui correspondrait à la nature même de la psychanalyse. Mais ce n’est pas du tout comme ça que les choses se sont passées ! Il y a eu tout un forçage, comme un lit de Procuste 2, et j’ai ressenti un certain malaise, je me suis dit mais c’est moi qui n’y comprends rien, ou alors c’est d’autre chose qu’il s’agit.
MN.C. - Vous avez parlé de vos propres références théoriques, l’importance de Winnicott. Est-ce que sur le plan des références théoriques vous partagiez beaucoup avec Denise Weill, ou est-ce qu’elle avait des références différentes ?
RC - C’est très difficile de vous répondre. Il y avait en effet entre nous, une sensibilité commune, des lectures communes, des goûts communs, une ambition commune et une complémentarité dans la tâche. C’était un peu lâche de ma part, mais comme elle était la patronne, il fallait qu’elle joue son rôle de patronne, et comme j’étais le technicien il fallait que je joue mon rôle de technicien. Mais contrairement à ce qui s’est passé par la suite, où les médecins, chefs ou directeurs ou responsables, se cantonnaient à ce qui était psy, je considérais que mon rôle en tant que médecin directeur ou médecin chef (ce n’est pas la même chose, mais ça revient au même en pratique), était d’avoir la responsabilité intégrale du fonctionnement thérapeutique de la boutique. Je considérais que le choix des collaborateurs et leur orientation faisaient partie de l’instrument thérapeutique, et que c’était à moi de choisir, sans subir de la part de l’administration toutes les contraintes personnelles des uns ou des autres, exactement comme n’importe quel médecin ou chirurgien fait ses choix techniques et responsables. Tel a toujours été mon point de vue. C’est-à-dire que j’ai été, je pense, particulièrement tolérant et attentif à ce qui venait d’autrui, et en même temps, particulièrement exigeant sur le plan des principes. Ce qui convenait, semble-t-il, assez bien à tout le monde. Cela créait une sorte d’unité qui faisait que, quand un parent ou un enfant arrivait dans la maison et y restait, il savait qu’il était en terrain familier, qu’il n’y avait pas de rupture ou de dissociation à l’intérieur de la boutique. C’est ce que j’avais appris de Georges Amado, et c’était très important.
Il existe une nostalgie des premiers temps où les gens venaient au CEREP. Cela a été pour eux à chaque fois une expérience particulièrement riche, et cela m’a toujours étonné, parce que je n’ai rien fait pour cela. Cela s’est passé comme ça, parce qu’à la fois, il n’y avait ni exigence spéciale ni idéologie orientée, mais l’écoute, et une façon de chercher des points communs pour les approfondir ensemble ou des points de divergences pour essayer de les affronter et d’en comprendre les raisons. Notre souci partagé était celui d’une action parallèle, à la fois psychothérapique et cognitive. C’était essentiel dans nos échanges et dans nos supervisions. J’ai supervisé aussi des pédagogues, et ça les intéressait beaucoup, cette possibilité pour eux d’entendre autre chose que la faute ou les déficiences. Ne pas en rester à l’insuffisance sur le plan des connaissances, mais tenter de comprendre les raisons qui amenaient ces enfants à ne pas pouvoir investir ce qui leur était proposé alors qu’ils étaient prêts à être attentifs et à s’intéresser à ce qui les entourait pour autant qu’on le leur permette et qu’on leur propose des choses qu’ils puissent prendre en compte. Cela aussi, ce sont des généralités assez banales, mais qui le sont moins que cela en a l’air.
MN.C. - Par rapport à la question de l’action thérapeutique et cognitive parallèle, vous dites que les pédagogues étaient très intéressés par des éclairages psychodynamiques, est-ce que, dans votre expérience au CEREP, les soignants étaient tout aussi intéressés par les aspects cognitifs ?
RC - Mais oui, et c’était d’autant plus important qu’il y avait le risque qu’ils glissent vers le psychothérapique exclusivement. C’était là l’une des difficultés de la tâche. On n’avait pas tellement d’outils à cette époque. Nous avions une visée de psychologie générale qui intégrait la psychanalyse, à moins que ce soit le contraire, la psychanalyse intégrée à la psychologie générale. Mais cela revenait au même parce que c’était une façon de faire disparaître la psychanalyse dans une autre discipline. Et ça a été reproché aux auteurs, d’avoir dilué la psychanalyse dans la psychologie, voilà exactement. Mais j’étais déjà assez content de trouver des lieux dans lesquels les deux dimensions se trouvaient articulées et reprises ensemble, ce qui n’était pas forcément le cas partout ailleurs. A l’époque, c’était une façon pour nous de viser une théorie générale de la vie psychique, au lieu de nous cantonner à notre spécificité. C’était écarter le risque que les thérapeutes puissent vivre la théorie psychanalytique comme s’il n’y avait rien de plus noble, de plus intellectuel, voire même de plus aristocratique, et qu’ils considèrent le pédagogique comme le côté besogneux, le côté fastidieux. J’ai eu affaire par exemple à une rééducatrice qui a été capable, sur le vif, de montrer à ses collaborateurs à quel point dans son travail de rééducatrice du français, de la langue et de la pensée, il y avait une richesse et une inventivité possible, tout un type d’échange inattendu et qui passait par la tâche officiellement scolaire. A partir du moment où le pédagogue avait découvert cela, il n’avait plus besoin de se sentir inférieur 3.
Il y a aussi une dimension que je n’ai pas évoquée, qui est la part de séduction dans la pédagogie. Il y a nécessairement une démarche de séduction dans la pédagogie sans que l’on s’en aperçoive. Il y a ceux et celles qui parviennent, à travers leur métier, à intéresser les garçons et les filles et leur faire investir la tâche à accomplir par un phénomène très simple. Ce phénomène, je l’ai évoqué dans mon rapport par un recours tout simple et unique à Lacan. Lacan disait, tout bêtement si je peux dire, que la tâche pédagogique, ça se limite à une identification. Et quand cette identification s’est produite à la fois sur le plan affectif, relationnel et cognitif, les choses deviennent plus claires et vont de soi. C’est à la fois par le transfert et par la tâche qui est dévolue au transfert qu’on fait avancer le schmilblick.
RC - Mais vous, (question adressée à ST - Serge Tisseron) vous avez une relation à la pédagogie assez importante. Est-ce que vous la retrouvez analogue ou différente de celle que je décris ?
ST - Je suis toujours étonné de voir comme les adolescents sont heureux de découvrir que certains adultes ne ressemblent pas à leurs parents, ou tout au moins à ce qu’ils croient que leurs parents sont. Les adolescents ont tendance à penser que les adultes ressemblent à l’imago qu’ils se sont fabriquée de leurs parents. Et quand ils rencontrent un adulte qui fonctionne autrement, qui se démarque de cet imago qu’ils se sont fabriquée de leurs parents, ils sont très en appétit d’une relation avec l’adulte.
RC - Si c’est pour une découverte, c’est possible de trouver cela intéressant et de l’investir.
ST - Absolument, c’est pour eux une très agréable découverte.
RC - Et votre travail par rapport au nôtre, si je puis dire, est-ce qu’il est semblable ou différent ? Dans la démarche technique liée aux adolescents, vous leur proposez une découverte technique ?
ST - Ils sont séduits de trouver quelqu’un qui s’intéresse à leurs centres d’intérêt comme la bande dessinée et les jeux vidéo. Même si leurs parents s’y intéressent aussi, ils ne s’y intéressent jamais comme les ados auraient envie qu’ils s’y intéressent, parce que c’est leurs parents.
MN.C - Ce n’est pas seulement que tu t’y intéresses c’est parce que tu t’y connais. Ça les étonne beaucoup.
ST. - Mais ils sont quand même très enclins à penser que je m’y connais plus que je ne m’y connais.
RC - Ça c’est le transfert.
1 Il s'agit de l'hôpital de jour André Boulloche à Paris dont Marie-Noëlle Clément est directeur.
2 Dans la mythologie, Procuste est un bandit qui allonge toutes ses victimes sur un lit et qui s'emploie ensuite par tous les moyens à les mettre à la taille de celui-ci. Et pour cela, il allonge les plus petits et raccourcit les plus grands, faisant évidemment mourir tout le monde...
3 Il s'agit de R-L. Richaud (2000), Une maïeutique du sujet pensant ou L'art, l'adolescent et son thérapeute, l'Harmattan.
- Interview intégrale : Carnet PSY 209 (juillet-août 2017), pages 34-43
Bibliographie de Raymond Cahn
- Ouvrages personnels
Le sujet dans la psychanalyse aujourd’hui (PUF)
Adolescence et folie, l’Adolescence et la Psychanalyse (PUF)
La fin du divan ? (Odile Jacob)
- En collaboration
Cahn R., Gutton P., Robert P., Tisseron S. (2013), L’Ado et son psy, ou la Psychanalyse à l’épreuve de l’adolescence (Inpress)
Il a aussi écrit de nombreux articles dans la Revue Adolescence.
- Autour de l’œuvre de Raymond Cahn
Vers un nouvel espace psychanalytique, 2009, Inpress.
Une quinzaine de psychanalystes réunis autour de Raymond Cahn présentent ses approches, discutent sa pensée et mettent en perspective son apport à la psychanalyse contemporaine.
Son dernier livre - Le sujet dans la psychanalyse aujourd’hui - comporte trois parties. La première partie, publiée initialement en 1991 à l’occasion d’un colloque débouche progressivement sur le concept de subjectivation en tant que processus de compréhension et d’appropriation de la vérité de l’interprétation psychanalytique. La deuxième partie, 25 ans plus tard permet le bilan de l’utilisation et des prolongements d’un tel concept qui s’enrichit avec le temps au point de proposer une nouvelle conception de la métapsychologie, et une écoute du matériel quelles que soient les circonstances de la rencontre avec un psychanalyste. Enfin, la troisième partie constitue une interprétation originale à partir des fondements établis par l’auteur de la création et du contenu des œuvres d’art dont la Joconde sert de modèle. Dans tous les cas de figures, c’est le problème posé par l’impossibilité pour de tels sujets à subjectiver qui se voit interroger pour déboucher sur le contre-transfert et un certain mode de compréhension de l’environnement.


